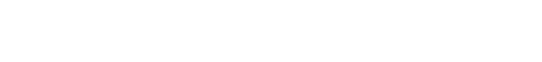Projet eurolije
Porté par les laboratoires EMA et Lirdef, le projet eurolije réunit une quinzaine d’enseignants-chercheurs, de chercheurs et de formateurs appartenant à des institutions différentes. La volonté qui anime ce collectif est d’interroger les pratiques culturelles réelles des jeunes, et d’analyser les formes prises par la médiation pour le livre, la lecture et la littérature pour jeunes publics, dans les institutions publiques (écoles, médiathèques), comme dans la société civile (associations) ou le monde économique (maisons d’édition, librairies).
Notre conviction est que cette analyse ne doit pas se limiter aux contours de la France mais porter sur l’Europe, en tant qu’entité géographique et culturelle.
Le projet eurolije résulte d’une double conviction :
– celle que les partenariats fructueux dans le domaine ne peuvent s’établir que sur la base d’une meilleure connaissance réciproque des acteurs, recherche et exercice professionnel ayant tout intérêt à s’articuler dans un secteur de création et de diffusion du livre qui représente un fort enjeu pour l’éveil des sensibilités, la formation des représentations, et la réflexion du jeune lectorat d’où seront issus les citoyens de demain.
– celle aussi que de nombreuses initiatives existent dans le domaine des médiations autour du livre jeunesse, qui gagneraient à se diffuser tandis que d’autres, parfois répandues, mériteraient d’être réinterrogées.
L’enjeu du projet eurolije est triple :
– faire un état des lieux des pratiques existantes en Europe dans les différents champs professionnels (école, bibliothèque, édition, librairie, association) ; tenter de les catégoriser mais aussi de reconstituer leur histoire (en fonction de cultures nationales ou transnationales).
– étudier la corrélation de ces pratiques contemporaines avec des objets spécifiques, avec la nature des acteurs qui y recourent mais aussi avec les types de publics concernés.
– diffuser à destination des médiateur·rice·s ces analyses et ces éclairages concernant les pratiques de médiation afin de participer à leur formation et de leur permettre de développer un rapport réflexif à leurs pratiques.
Équipe
Lucile Berthod
Lucile Berthod est doctorante au sein du laboratoire ÉMA (École, Mutations, Apprentissage) Université CYU en 3ème année de thèse. Sa recherche doctorale dirigée par Marie-Laure Élalouf et co-encadrée par Lydie Laroque porte sur l’impact des actions de médiation d’albums narratifs jeunesse en classe de cours préparatoire sur la posture de lecteur des élèves et notamment des élèves en retrait que Serge Boimare nomme les empêchés d’apprendre.
Elle est professeure des écoles dans le Jura et formatrice à l’INSPÉ de Franche-Comté.
Elle a été étudiante en Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation – Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre et de la lecture pour jeunes publics de l’INSPÉ de Versailles. Dans ce cadre, elle a été pendant 3 mois témoin et actrice de la démarche de création d’épisodes de la série télévisée Yétili (France Télévisions).
Elle a mené depuis ce stage des actions de médiation d’albums jeunesse par le biais de cette série, dans différentes classes d’école maternelle et de cours préparatoire.
Comment considérer les pratiques familiales de l’écran pour développer une appétence à la lecture et dynamiser le projet personnel de lecteur ?
Dernières publications
Berthod Lucile :
« Une lecture polyglotte de l’album
La Grenouille à grande bouche », Le
Français aujourd’hui, à paraitre dans le n° 215, 2021/4.
Berthod Lucile, Laroque
Lydie, « Lectures réelles et lectures prescrites au CP. Quelle
articulation ? », Revue Strenae
n° 19 (Objets culturels de l’enfance), 2021.
Dernières publications
Boutevin, C. (2018). Livre de poème(s) et poème(s) en livre pour la jeunesse aujourd’hui. Pessac, Presses universitaires de Bordeaux.
Boutevin, C. (2021). Vigueur du haïku dans la poésie pour l’enfance et la jeunesse : adaptation et/ou effets d’une scolarisation ?. Le français aujourd’hui, 213, 31-40. https://doi.org/10.3917/lfa.213.0031
Boutevin, C., Sauvaire, M. et Torterat, F. (coord.) (2021). Approches plurielles de la littérature de jeunesse auprès des jeunes enfants. Tréma, 55. https://journals.openedition.org/trema/6452
Christine Boutevin
Christine Boutevin est maitresse de conférences en langue et littérature françaises à la Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier. Au sein du LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Education et Formation), ses travaux portent sur la poésie pour l’enfance et la jeunesse et plus généralement sur la littérature à destination des enfants. Ils articulent objets littéraires, y compris numériques, et éducation (didactique de la littérature et médiation) en prenant en compte les théories du sujet lecteur et l’interdisciplinarité avec les arts plastiques et visuels. Codirectrice de publication des Carnets de poédiles, une revue en science ouverte créée en 2023 et hébergée sur Pergola, la pépinière de revues de la Maison des sciences de l’homme en Bretagne, Christine Boutevin mène un travail éditorial et scientifique visant à encourager des expériences poétiques de l’école maternelle à l’université.
Elle intervient au niveau licence et en Master médiation artistique et culturelle où elle anime des ateliers d’écriture ainsi que dans le master MEEF 1er et 2d degré à la Faculté d’éducation et à l’INSPE de l’académie de Montpellier.
Depuis 8 ans, elle mène également des actions de médiation auprès des enfants de 5 à 8 ans au sein de la médiathèque de Commensacq (40) et en partenariat avec l’école du RPI (Réseau Pédagogique Intercommunal).
Enfin, en tant que poétesse et chercheuse, Christine Boutevin est également membre du conseil d’administration de l’Association Francophone du Haïku, du comité de rédaction de la revue Gong et du comité éditorial de la collection « Solstices » de cette association.
Marthe Fradet-Hannoyer
Marthe Fradet-Hannoyer est maitresse de conférences à l’Université de Clermont Auvergne.
Elle est formatrice à l’INSPE de Clermont Auvergne après avoir été professeure des écoles. Elle intervient au sein du Master MEEF 1.
Elle est rattachée au sein du laboratoire ACTE (Activité, Connaissances, Transmission Education) et est également chercheuse associée au laboratoire École, mutations, apprentissages (CY Université).
Ses recherches portent sur le rapport à la littérature des professeurs des écoles débutants et sur ce qui détermine aux niveaux personnel, social, institutionnel et historique leurs façons de lire et leurs manières d’enseigner la lecture des textes littéraires.
Marthe Fradet-Hannoyer est membre d’une équipe de recherche (T-Prof®) qui développe un simulateur numérique d’enseignement et analyse les potentialités de la simulation dans la formation professionnelle. Dans ce cadre, elle s’intéresse en particulier aux usages des outils numériques en formation et, plus particulièrement, à leurs effets sur les dispositions des enseignants à lire et faire lire des œuvres littéraires.
Dernières publications
Fradet-Hannoyer M (2021), Manières de lire, façons d’enseigner. Dispositions à lire et à faire lire des textes littéraires chez les professeurs des écoles débutants. Thèse de doctorat soutenue en novembre 2019. Thèse en ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-03095558
Fradet-Hannoyer M. (2020), « Place et rôle de la recherche en didactique de la lecture dans un module de formation initiale de professeurs des écoles », In E. Falardeau (dir.). Diffusion et influences des recherches en didactique du français. 13è colloque de l’Association Internationale de Recherche en Didactique du Français (AIRDF), UQAM, Montréal, 25-26-27 août 2016. Namur : Presses Universitaires de Namur
Lydie Laroque
Lydie Laroque est maitresse de conférences en langue et littérature françaises à l’INSPE de Versailles (CYU Paris-Cergy université). Elle enseigne dans le Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation – Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre et de la lecture pour jeunes publics de l’INSPE de L’Académie de Versailles.
Elle enseigne également dans le master MEEF-1 (professeurs des écoles) et dans le master médiation culturelle de l’INSPE de L’Académie de Versailles.
À l’Université de Cergy-Pontoise, sa recherche s’inscrit au sein du laboratoire École, mutations, apprentissages.
Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la littérature de jeunesse, la didactique de la littérature et les mythes bibliques. Ils visent à articuler des problématiques littéraires (autour notamment du mythe et de la fiction historique) avec des questions éducatives comme les valeurs, l’éthique, l’inclusion, la médiation.
Lydie Laroque est aussi membre du comité de rédaction de la revue Le Français aujourd’hui, membre de l’Association française pour l’enseignement du français, membre de l’Association internationale pour la recherche en didactique du français et membre du conseil d’administration de l’association Lecture jeunesse.
Dernières publications
Lydie Laroque, « L’œuvre d’Antonin Louchard : humour et poésie pour petits et grands », in Le Français aujourd’hui 2022/2 (N° 217).
Lydie Laroque, « Histoires ou Contes du temps passé de Perrault en extraits dans les manuels français du cycle 3 », Repères, 64 | 2021, 77-90.
Véronique Bourhis, Lydie Laroque (dir.), « Littérature de jeunesse et plurilinguisme », Le Français aujourd’hui 2021/4, (n° 215)
Dernières publications
Marion Mas
Marion Mas est maitresse de conférences en littérature et langue françaises à l’ESPE de Lyon. Elle intervient comme formatrice dans le master MEEF. Ses recherches s’inscrivent au sein de l’IHRIM (Institut d’Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités) où elle coordonne le groupe de travail « Fablijes 18/21 » (Fabriques des littératures de jeunesse, XVIIe-XXIe siècles). Ses travaux portant sur la littérature de jeunesse privilégient une approche historique et sociocritique. Ils s’intéressent tout particulièrement aux mises en texte (et en jeu) des normes et du discours éducatif.
Elle chronique également régulièrement des ouvrages de littérature de jeunesse contemporaine pour le site Li&Je.
Christine Mongenot
Christine Mongenot est maitresse de conférences en langue et littérature françaises. Elle a longuement enseigné à l’Espé de Versailles (Université de Cergy Pontoise) où elle a participé en 2012 à la création du Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation – Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre et de la lecture pour jeunes publics qu’elle a dirigé de 2015 à 2018. Elle y a également dispensé des enseignements, en particulier sur l’histoire de la littérature de jeunesse, sur son écriture spécifique et sur les questions d’adaptation.
Récemment retraitée, elle est membre associé du laboratoire AGORA (EA 7392).
Ses travaux de recherche portent essentiellement sur la littérature de jeunesse dans une double perspective : spécialiste du XVIIe siècle, elle a consacré sa thèse à la naissance du théâtre d’éducation et travaille plus largement sur l’émergence de certains genres dédiés à la jeunesse, et plus particulièrement aux filles, à l’articulation des XVIIe et XVIIIe siècles. Mais un autre pan de ses travaux s’attache aussi aux formes contemporaines des productions pour la jeunesse dans une perspective genrée.
Christine Mongenot est membre du comité de rédaction de la revue Le Français aujourd’hui, et membre du bureau de l’association Lecture jeunesse.
Dernières publications
MONGENOT, C., (dir.), Une littérature de jeunesse européenne au XXIe siècle?, Cahiers Robinson, N°46, 2019 (avec introduction).
MONGENOT, C., « Des femmes illustres aux jeunes personnes célèbres. Acclimatation des figures héroïques féminines dans la littérature d’éducation destinée aux filles (XVIIe-XVIIIe siècles) », Héroïsme féminin et femmes illustres (XVIIe-XVIIIe siècles). Une représentation sans fiction, Schrenck, G., Spica, A.-E., Thouvenin, P. (dir.), Editions Classiques Garnier, coll. Masculin /féminin dans l’Europe, 2019, p. 347-370.
MONGENOT, C., « De vous à moi. Détours et mise en scène pédagogique dans l’entretien éducatif », L’Entretien au XVIIe siècle, Cousson, A. (dir.), Editions Classiques Garnier, 2018, p. 319-343.
MONGENOT, C., Mercier, A.-M. (dir.), Le Français aujourd’hui, N°206, septembre 2019 ( avec introduction, « Le Roi vient quand il veut: Les auteurs à la rencontre des publics scolaires », p. 3-10).
Dernières publications
Richard-Principalli P. (2023). Littérature enfantine et communisme. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux.
Richard-Principalli P. (2022). Louise Michel, une auteure pour enfants en quête de patrimonialisation. Dans A. Gennaï, P. Richard-Principalli et C. Boutevin (dir.), Défense et illustration de la didactique de la littérature. Montréal : Presses de l’écureuil.
Richard-Principalli P. (2021). L’Homme qui plantait des arbres, de Jean Giono : une adaptation jeunesse et des usages scolaires singuliers. Le français aujourd’hui, 213, p. 99-110.
Patricia Richard-Principalli
Patricia Richard-Principalli est maitresse de conférences HDR en langue et littérature françaises à la Faculté d’éducation de l’Université de Montpellier. Ses recherches s’inscrivent au sein du LIRDEF (Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation). Ses travaux portent sur l’usage scolaire de la littérature de jeunesse ainsi que sur les aspects génériques et les enjeux de cette littérature.
Elle intervient dans le master MEEF à la Faculté d’éducation et à l’ESPE Languedoc-Roussillon.
Patricia Richard-Principalli est également membre de l’Afreloce (Association Française de Recherche sur les Livres et les Objets Culturels de l’Enfance), ainsi que de l’ERITA ( Équipe de Recherche Interdisciplinaire sur Louis Aragon et Elsa Triolet) et du comité de rédaction de la collection « Recherches Croisées Aragon/Elsa Triolet » aux Presses Universitaires de Strasbourg.
Kathy Similowski
Kathy Similowski est maitresse de conférences en sciences du langage à CY Cergy Paris Université et dispense un enseignement en littérature de jeunesse en MEEF1 (professeurs des écoles) à l’INSPÉ de l’académie de Versailles, notamment dans l’option littérature de jeunesse à distance. Elle a soutenu une thèse à l’Université de Paris-Sorbonne en 2017 sous la direction de Sylvie Plane, Professeure à l’Université de Paris-Sorbonne et à l’ÉSPÉ de Paris, aujourd’hui émérite, portant sur l’articulation entre écriture et lecture de textes littéraires à l’école primaire. Ses travaux ont conduit à des publications concernant en particulier le genre de la robinsonnade. Avec d’autres chercheurs du laboratoire École Mutations Apprentissages, elle s’intéresse à l’une des difficultés majeures entravant la compréhension du langage chez l’enfant à savoir la détection et l’interprétation des implicites structurant les textes (projet coordonné par B. Godart-Wending, HDR CNRS). Kathy Similowski est également rédactrice de dossiers pédagogiques pour l’éditeur de littérature de jeunesse l’École des loisirs.
Dernières publications
Similowski K (2020) « Dépassement et naufrage mental dans l’ile de Robinson : l’écriture de robinsonnades à l’école primaire » dans Jules Verne et Robinson, actes des 6èmes rencontres Jules Verne. Coordonné par P. Mustière et M. Fabre. Nantes : éditions Coiffard. p. 241-247.
Similowski K. (2019) « Écriture et lignes de fractures : le plagiat et la contrefaçon en droit français ou les limites de l’imitation », Revue algérienne des lettres, n°3
Similowski K., Pellan D. et Plane S. (2018) « Que révèlent les traces de réécriture dans les brouillons d’élèves produisant des récits à partir de sources littéraires ? » Repères, n°57, Collecter, interpréter, enseigner l’écriture, sous la direction de J. David et C. Doquet.
Publications en littérature de jeunesse
Virginie Tellier
Virginie Tellier est maitresse de conférences en langue et littérature françaises à l’INSPE de Versailles (CY Cergy Paris Université). Elle est responsable du Master MEEF Pratiques et ingénierie de la formation – Littérature de jeunesse : formations aux métiers du livre et de la lecture pour jeunes publics de l’INSPE de L’Académie de Versailles.
Sa recherche s’inscrit au sein du laboratoire École, mutations, apprentissages dont elle est actuellement directrice-adjointe.
Ses travaux de recherche abordent la littérature de jeunesse dans une double perspective historique et comparatiste. Ils portent sur l’histoire des littératures et cultures de jeunesse en Europe, en la confrontant à l’histoire de l’éducation et des mentalités. Ils s’intéressent également aux transferts culturels entre aires linguistiques et entre médias. Enfin, ils visent à développer la médiation des littératures étrangères, notamment dans le cadre de la didactique de la littérature comparée.